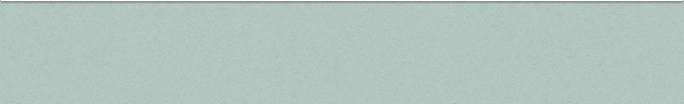Charte de la philothérapie
Charte fondatrice de la philothérapie
La philothérapie, telle que nous la concevons, se donne pour but premier entre toutes les choses, de conduire et de guider la personne qui en ferait la demande, vers un certain sens et un certain bonheur auquel elle tend.
Pour ce dessein, la philosophie réelle se considère comme un moyen, et l’ensemble des sciences et des connaissances qu’elle coordonne et hiérarchise sont soumises à ce but que justifie seul le chemin parcouru vers un progrès de l'existence heureuse.
Le philothérapeute ne connaît la personne à laquelle il apporte son aide que comme un sujet absolu et libre, pleinement responsable du devoir de travailler à son propre bonheur.
Par conséquent, il ne porte pas de jugement de valeur relatif à des questions de religiosité, de mœurs, de statut, de profession, de nationalité ou d’ethnie, de politique, de degrés de conscience, etc, bien qu’il ait à aborder ces questions comme un déterminisme possible.
Le sujet libre doit être conscient de ses propres forces et de ses capacités mentales et morales à partir desquelles il aura à travailler et agir par lui-même vers le progrès ou le dénouement auquel il aspire ou qui à été mis en évidence et perçu comme atteignable par les deux parties.
Les problématiques soulevées collégialement, bien que pouvant relever de démarches complexes, issues d’intelligences diverses et de principes rationnels et moraux variées, secouées ou non de passions et de vicissitudes existentielles, ne peuvent en aucun cas consister en des justifications directes qui légitimeraient d’une manière ou d’une autre la nuisance de l’entourage familiale, professionnel ou sociétal.
Le philothérapeute n’use pas de son statut pour intimer plus ou moins insidieusement des théories ou des systèmes de pensée relatifs propre à une secte, une école, un parti politique ; mais il peut user des pensées que l’histoire de l’intelligence, les philosophes de tous temps, les penseurs et les scientifiques dont la philanthropie est avérée, peuvent être mis judicieusement à profit pour démêler les impasses et les problèmes existentiels dans lesquels peuvent se situer en conscience une personne.
La déontologie du philothérapeute consiste dans une simple discrétion de convenance avec la personne aidée. La philothérapie, ne présupposant ni ne cherchant de maladie mentale ou psychologique d’une part ; les réflexions et les démarches qui en sont extraites étant conjointement l’œuvre des deux parties en exercice ; d’autre part, elles peuvent être, selon accord signé et consentit librement, l’objet de publications et d’articles sous couvert d’anonymat ou non, dans la mesure où ces publications constituent un exemple intéressant, digne du bien commun.
Le philothérapeute pouvant néanmoins être confronté à des personnes dont le désarrois ou les inclinations peuvent être dommageable pour elles-mêmes ou l’entourage, il peut être d’un conseil privilégié pour orienter vers une aide psychiatrique ou psychologique un personne soumise à des affections qu’elle ne peut supporter, et dont l’intensité affecterait un temps leur libre conscience.
Le philothérapeute ayant, à l’égard des personnes auxquelles il apporte son aide, une bienveillance naturelle et une humanité propre aux philosophes de notre temps, il prendra soin de se prémunir de toute ambiguïté de nature affective ou intellectuelle, et de tout abus qui tombe d’une manière ou d’une autre sous le coup de la Lois, par l’usage d’une attitude professionnelle exemplaire dont les principes d’écoute et d’autorité seront appliqués avec la subtilité qui convient à chaque cas particulier.
Pour se prémunir de tout transfert (psy) et pour garantir la sécurité des deux parties, le philothérapeute aura donc la tâche explicite de manifester et de signifier en quoi son acte, par le jeux de questions judicieuses et à-propos et ses démarches d’introspections, relève d’une intention seconde fondamentale pour le but fixé, et ne consiste en aucun cas en des manières de constituer une intersubjectivité ou des formes relationnelles.
Un esprit pénétrant et l’expérience du philothérapeute doivent lui donner l’assurance et l’autorité de couper cours à toute dissolution du dialogue dans des affects ou des sentiments dont l’affection supplanterait absolument la maîtrise de soi. Par ailleurs, comme le caractère introspectif de la notion philosophique de la thérapie doit demeurer à ce titre dans son fondement naturel, l’immanence de la rencontre doit se conformer sur une mutuelle bienveillance de bon alois.
Les démarches de définition, d’acquisition de la personnalité et tout autre approfondissement plus ou moins intimes auxquelles se livre un sujet, doivent être connues des deux parties comme n’ayant qu’un but pour le philothérapeute de saisir et de cerner ce qui est directement utile à la problématisation, la résolution, l’assimilation et la mise en pratique qu’il présente au bon vouloir et à la susceptibilité du sujet qu’il établit avec lui et dont il prend acte.
Pour résoudre les impasses existentielles dans lesquelles une personne a le sentiment d’être, le philothérapeute aura à cœur de comprendre jusqu’aux considérations les plus satisfaisantes pour son esprit de philosophe, ce à quoi les principes de bonheurs, de bien souverain, lui sont intimement liés. Aussi, nous considérons qu’un philothérapeute doit se savoir suffisamment empli de ce bonheur selon sa vocation et sa propre démarche, et selon un accord universel de son état d’avec son monde actuel pour s’estimer propre à communiquer, si ce n’est par l’esprit, tout au moins par l’état, la singulière capacité d’un ami de la sagesse à se conduire lui-même malgré les difficultés de la vie. Nous recommandons donc, plus qu’une grande sagacité et une aptitude scolaire aux universités, une profonde expérience de la vie bien que les études de philosophie peuvent parfois en faire appréhender en raccourcis la teneur. Nous tenons comme perfectible la simplicité du déroulement existentiel tel qu’il peut être appréhendé par toutes les circonvolutions et la subtilité de la pensée humaine, jusqu’au point d’étalement de la simple réalité telle qu’elle est donnée aux hommes et selon leur capacité et leur dignité à ce qu’en justice ils peuvent en faire ou en espérer.
Carol Louis Bitonti